Les relations sexuelles étaient également prohibées entre une mère et son fils. Le juron : « Urabe unyambuye : que tu me déshabilles (euphémisme pour dire ‘‘que tu fasses des rapports sexuels avec moi’’) était lancé par une mère dans une situation grave dans la quelle elle ne pouvait dissuader son fils autrement. Celui-ci ne pouvait en aucun cas passer outre. L’un des rares cas connus d’inceste entre un fils et sa mère est relaté dans les récits mythiques de Ryangombe qui aurait eu un enfant, du nom de Nyabirungu, avec sa mère Bigaragara.
Les rapports sexuels entre une sœur et son frère, et entre une nièce et ses oncles étaient incestueux et donc interdites. Les relations entre une nièce (umwishywa) et son oncle étaient caractérisées par une très grande susceptibilité. Un oncle ne pouvait rien refuser à sa nièce. Pour devancer, il devait lui donner un cadeau chaque fois que l’occasion de la rencontrer se présentait. Il ne devait jamais lui faire pleurer sous aucun prétexte. Le juron : « Ndakenda umwishywa : que j’aie des rapports sexuels avec une nièce » était le plus grave qu’un homme pouvait prononcer.
Cette interdiction était également de règle entre un neveu et ses tantes. Le proverbe : « Inkururarusya iswika nyirasenge. : le tireur des poils du pubis (le débauché) fait l’amour avec sa tante paternelle ». S’il arrivait à un neveu de transgresser ce tabou, il aurait tous les malheurs du monde.
Etaient également prohibées les relations sexuelles entre un homme et une fille, même majeure, d’un voisin ayant le même âge que lui. Celui-ci considérait la fille comme son enfant car ayant le même âge que ses ouailles. Une union quelconque avec elle équivaudrait donc à « déshabiller l’enfant » (kwambura umwana), c’est-à-dire avoir des relations sexuelles incestueuses avec sa fille. Cette ’’perversion’’ était admise par contre dans le cas des filles offertes (gutura umwana) aux représentants de Ryangombe (abagirwa), pratique en vigueur surtout dans les régions du Nord du Rwanda dans les préfectures actuelles de Ruhengeri et de Byumba. L’objectif de cette offrande était de solliciter la protection des dieux. Quel que soit l’âge de l’umugirwa, la fille devait lui ‘‘bourrer la pipe’’ (gutekera itabi). Les personnes âgées, une fois au lit, le soir, devaient fumer la pipe avant de s’endormir. C’était le rôle de la femme de chercher la pipe de son mari et de le lui apporter au lit. L’homme, après avoir tiré quelques bouffées, enlaçait sa femme et lui faisait l’amour. Il en était ainsi pour la fille offerte. Lui demander de « bourrer la pipe » était synonyme de l’inviter au lit. L’umugirwa couchait avec la fille sans autre considération, cérémonie religieuse oblige.
Les enfants nés des unions incestueuses avaient un nom spécial : ‘‘amacugane’’ (les intracroisés). Il s’agit en fait d’un mot emprunté chez les éleveurs qui, pour améliorer la race du bétail, évitait de croiser les animaux issus d’un même géniteur.
Cependant, à en croire les écrits de ceux qui ont observé les mœurs de l’époque ancienne, des cas d’inceste pouvaient s’observer dans la haute classe de l’ancien Rwanda. Ainsi Louis de Lacger a relevé chez les Rwandais des mœurs « païennes et barbares », mais aussi «le viol, les commerces illicites jusqu’à l’inceste ». Ce constat, il l’a fait dans la classe aristocratique : « Ce n’est pas dans la classe populaire que les mœurs sont le plus dissolues ni même le plus brutales. S’il était un milieu où la dépravation s’affichât naguère avec le plus de cynisme, c’était humainement le plus distingué, celui des riches et des puissants. C’est dans la noblesse surtout que sévissaient (…) les vices contre nature, la débauche, l’envie avec toutes les manœuvres perfides (…) qu’elle suggère (…). Quant au prince polygame, pas plus à lui qu’à eux, femmes et concubines ne suffisaient à apaiser sa lubricité (…). Les enfants, filles et garçons, n’essayaient pas de se dérober aux caresses voluptueuses de leur père » (Louis de Lacger, Le Ruanda, Kabgayi, 1939, pp.134-135).
La cour royale était réputée pour la dépravation des mœurs et le roi n’était pas souvent en reste. Selon A. Pagès : « Les mœurs des grands chefs étaient, certainement, fort dépravées. L’inceste n’était pas inconnu malheureusement ; il se pratiquait au vu et au su de familiers qui n’en parlaient qu’avec répugnance. L’exemple, d’ailleurs, partait du plus haut sommet de l’échelle sociale. Le ‘Mwami’ actuel, car c’est de Musinga que nous parlons, est d’une amoralité absolue. Pour lui aucune règle, aucune réserve, d’où le mot trop fréquent dans la bouche des dignitaires indigènes : ‘‘ Il nous fait honte !’’» (A. Pagès, Cérémonie de mariage au Rwanda (suite), Congo, Revue générale de la colonie belge, Tome II, n°1, Bruxelles, août 1932, p.67).
Anicet Kashamura relève, lui aussi, qu’il y a effectivement une corrélation entre la dépravation des mœurs et les classes sociales. Si les « tabous et interdits régissent les valeurs sociales, culturelles, morales, esthétiques des individus, établissent une certaine convergence entre leurs intérêts, garantissent l’ordre et la sécurité collective (…), c’est presque toujours sur les classes dominées, exploitées, que ces règles pèsent lourdement. Ainsi les seigneurs, s’ils ont leurs tabous particuliers, s’affranchissent d’un grand nombre d’interdits qui réglementent la vie de leurs vassaux hutu : l’inceste ne leur est pas défendu... » Anicet Kashamura, famille, sexualité et culture. Essai sur les mœurs sexuelles et les cultures des peuples des Grands Lacs africains. Paris, Payot, p.140). Il souligne même que de nombreux mythes expriment le caractère sacré de l’inceste et son rôle aux origines de la monarchie tant au Rwanda que dans les autres royaumes de la région des Grands Lacs africains.
Maquet a recensé les différentes catégories de personnes qui ne pouvaient pas se marier entre elles à cause de leurs liens de consanguinité ou d’affinité. Braver cette interdiction était ni plus ni moins commettre une sorte d’inceste. Ainsi les descendants dans la lignée patrilinéaire d’un ancêtre commun ne pouvaient pas se marier entre eux. Ce tabou s’appliquait au groupe de parenté maternelle car ce serait horrible et contre nature d’envisager une relation conjugale entre une mère et ses descendants et à toutes les personnes assimilées à la mère comme ses sœurs et ses cousins parallèles.
Cette prohibition s’appliquait également aux beaux-parents : un homme ne pouvait pas avoir des relations sexuelles à la fois avec sa femme et avec la mère de celle-ci. Tous les parents assimilés à la belle-mère se trouvaient dans la catégorie prohibée. Rentrent dans cette dernière catégorie également les nièces et les petites-nièces sororales d’un homme, celui-ci devant se comporter vis-à-vis d’elles comme un oncle même si elles appartenaient à un autre patrilignage. Une extension de ce tabou concernait les époux des oncles et des tantes car le conjoint d’une tante était considéré comme un oncle et vice-versa. La conclusion à laquelle est arrivée Maquet est que les tabous de mariage et de relations sexuelles avaient parfois le but ou la fonction de garder une certaine cohésion à l’intérieur du groupe des parents par consanguinité et affinité, en empêchant que ne naissent des rivalités et conséquemment des éclatements des lignages (Jean-Jacques Maquet, Le système des relations sociales dans le Rwanda ancien, Tervuren, 1954, p.82)..
Quelques exceptions méritent cependant d’être signalées. Dans des familles pauvres où le jeune avait de la peine à trouver la dot, il lui était arrangé un mariage avec sa cousine croisée du côté maternel. 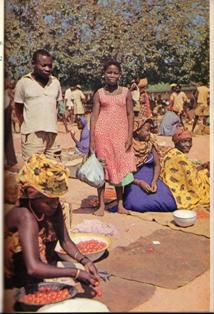
Il est à noter ici que la notion de ‘‘cousins croisés’’ est très étendue. Les cousins croisés peuvent être notamment, selon les peuples, les enfants d’un homme et ceux de sa sœur ou de son frère ; les enfants d’une femme et ceux de sa sœur ou de son frère. Par ailleurs la coutume du mariage entre cousins croisés n’est pas que rwandaise. Elle se retrouve dans plusieurs régions du globe : « Aux Indes dans la province d’Assam, dans plusieurs tribus d’Australie et de la Mélanésie ; (…) on la retrouverait même en Sibérie et en Amérique ; parmi les populations primitives on la rencontre chez les Vedda de Ceylon et les Naman (Hottentots) ; mais c’est peut-être en Afrique qu’elle est actuellement le plus largement répandue notamment parmi les populations soudanaises d’Ashanti et de Jibu (sous-tribu des Jukun) de la Nigérie ; Hamites Peuls de la Guinée Française et demi-Hamites du Ruanda et surtout parmi maintes tribus bantoues tant de l’Afrique du Sud que du Nyassaland et du Congo Belge ». (Jacques Delaere, A propos des cousins croisés, Bulletin des juridictions indigènes et du droit coutumier congolais, 14è année, n° 11, septembre-octobre 1946, p. 347).
Dans de tels mariages entre cousins, même si dot il y avait, il n’était pas élevé. En principe, la vie familiale était plus intime et plus harmonieuse dans de tels mariages et il y avait moins de difficultés de cohabitation entre la femme et sa belle-mère, celle-ci ayant pour bru sa propre nièce.
Le mariage entre les cousins relevait d’une certaine subtilité de la culture rwandaise. Ainsi, si un mariage était arrangé entre une cousine croisée du côté maternel comme nous l’avons souligné plus haut, il était tenu compte du principe qu’ une nièce peut « remettre le couvercle sur le petit panier de sa tante » (umwisengeneza ajya gupfundikira igiseke cya nyirasenge) Autrement dit, une fille peut aller chercher le mari dans la famille dans laquelle s’est mariée la sœur de son père (nyirasenge). Le petit panier était symbole non seulement d’amitié mais aussi de confidentialité car il servait entre autres à garder ‘‘le trésor caché’’ de la femme (ses accessoires intimes, ses charmes…). Ce n’était pas n’importe qui qui pouvait accéder à ce panier, sauf la fille aînée de la mère ou la belle-fille choyée par sa belle-mère. Une fille pouvait donc épouser le fils de la sœur de son père, qui est son cousin croisé du côté maternel. L’nverse n’est pas faisable car « une fille ne peut revenir dans la maison » (nta mubokwa usubira mu rugo). Le mariage entre une fille et le fils du frère de son père ne pouvait pas être arrangé. Sinon, ce serait « un retour à la maison », dans la lignée paternelle, le système familial rwandais étant patriarcal.
Le mariage entre cousins croisés devait éviter de tomber dans une union considérée comme incestueuse par la coutume. Ainsi, le mariage entre des enfants d’une femme et ceux de sa sœur n’étaient pas possibles. Car cette dernière ne pouvait jamais, selon la coutume, se refuser au mari de sa sœur si l’occasion se présentait. L’un ou l’autre de ses enfants et ceux de sa sœur étaient donc considérés de ce fait, comme pouvant être éventuellement issu d’un même géniteur. Ils seraient alors plus des frères et des sœurs que des cousins. Le mariage entre eux était donc déconseillé. Par contre, le mariage était possible entre les enfants d’une femme et ceux de son frère. Les relations sexuelles entre un homme et sa sœur étant prohibées, il n’y avait aucune probabilité que certains de leurs enfants partagent un même géniteur. Ils appartenaient dans des clans et dans des lignées différentes. Le principe du « non retour de la fille à la maison » s’appliquait évidemment.
D’une manière générale cependant, des relations sexuelles entre un cousin et une cousine étaient tolérées. Une liberté sexuelle était même carrément reconnue par la tradition entre cousins croisés. On la désignait pudiquement par le terme « guterana ububyara » (se jeter le cousinage). L’expression signifie vulgairement «manifester sa familiarité, lors des blagues entre les personnes du même âge ». Le garçon, devenu jeune homme, était encouragé à fréquenter ses cousines croisées mariées afin qu’elles lui donnent des leçons sur la sexualité, théoriquement et pratiquement. Les proverbes suivants illustrent ce phénomène : «Utazi ko inshuti zashize agira ngo ejo azahura na mubyara we. : Celui qui ignore qu’il n’y a plus d’amis espère que demain il rencontrera sa cousine croisée ». Car elle était toujours disposée à aider son cousin notamment en matière sexuelle.
Dans le domaine des rapports sexuels, la consanguinité était, à tous les degrés de la lignée masculine, une cause d’empêchement au mariage. C’est peut-être pourquoi, exceptionnellement, des relations sexuelles entre un gendre et sa belle–mère, qui officiellement étaient considérées comme incestueuses, pouvaient quand même être tolérées si l’occasion se présentait. Les proverbes suivants sont éloquents à ce sujet : « Nyokobukwe si umuko : Une belle-mère n’est pas comme une erythrine » ; « Iyo nyokobukwe akunze ukurura ihururu : Si ta belle-mère est d’accord, tu tires son pagne de peau (tu la déshabilles pour faire l’amour avec elle) » ; « Umukwe w’isoni ahera mu mfuruka : Un gendre timide reste confiné dans un coin de la maison ; il n’ose pas rejoindre sa belle-mère au lit si l’occasion se présente ». De ces proverbes, il ressort que la belle-mère n’était pas à éviter comme l’érythrine qui a des épines. La réserve qu’il y avait dans les relations entre un gendre et sa belle-mère ne constituait pas un tabou sexuel. Un homme ayant réalisé l’exploit d’avoir des relations sexuelles avec sa belle-mère (kwenzuza) avait donc à la fois couché avec sa femme et avec la mère de sa femme (kwenda umwana na nyina). La coutume lui reconnaissait la capacité d’éloigner les fourmis qui envahissent les habitations (gutsirika intozi). Il était recherché pour la circonstance. Il suffisait qu’il crache sur ces insectes pour qu’elles prennent la fuite
En matière de consanguinité, il est établi qu’à partir de la troisième génération, toutes les barrières au mariage étaient de plus en plus levées ou n’étaient quasi pas prises en considération.
[Pour plus d’informations, procurez-vous le livre de Gaspard Musabyimana, Pratiques et rites sexuels au Rwanda, Paris, Editions L’Harmattan, 2006].
/image%2F1217535%2F20150701%2Fob_940c7d_sexualite-et-rites-amazon-copie.jpg)



/image%2F1217535%2F20150701%2Fob_54d58b_sexualite-et-rites-amazon-copie.jpg)
 Chez la femme,
Chez la femme, Dans les années quarante, le gynécologue allemand Ernst Grafenberg signala dans ses travaux la découverte d'une zone érogène située dans la paroi avant du vagin. Lorsque, par la suite, d'autres chercheurs, les Américains Beverly Whipple et John Perry, découvrirent que cette zone existait bel et bien, ils lui donnèrent le nom de G-spot (G pour Grafenberg). Ils s'aperçurent également qu'une femme qui atteint l'orgasme par la stimulation de cette zone sécrète une petite quantité de liquide blanc. Celui-ci s'est révélé avoir la même composition que le liquide sécrété par la prostate chez l'homme. Ils ont également découvert des plexus nerveux (réunion de plusieurs terminaisons nerveuses) semblables dans la prostate et dans la zone G.
Dans les années quarante, le gynécologue allemand Ernst Grafenberg signala dans ses travaux la découverte d'une zone érogène située dans la paroi avant du vagin. Lorsque, par la suite, d'autres chercheurs, les Américains Beverly Whipple et John Perry, découvrirent que cette zone existait bel et bien, ils lui donnèrent le nom de G-spot (G pour Grafenberg). Ils s'aperçurent également qu'une femme qui atteint l'orgasme par la stimulation de cette zone sécrète une petite quantité de liquide blanc. Celui-ci s'est révélé avoir la même composition que le liquide sécrété par la prostate chez l'homme. Ils ont également découvert des plexus nerveux (réunion de plusieurs terminaisons nerveuses) semblables dans la prostate et dans la zone G.